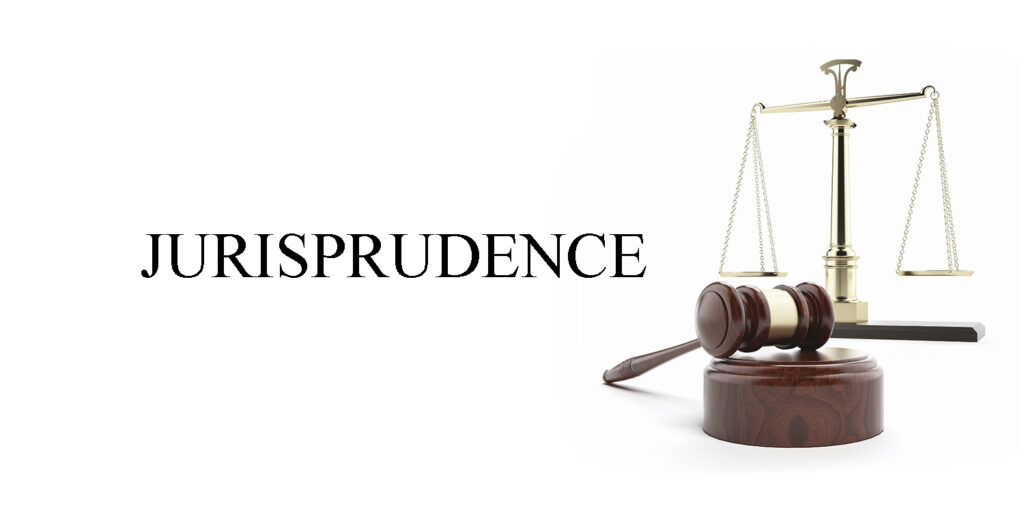Grimard c. Canada (2009 CAF 47)
« Contrat de travail vs Contrat d’entreprise »
La Cour fédérale d’appel qui entend notamment les appels de la Cour canadienne de l’impôt a rendu, le 19 février 2009, un jugement qui confirme diverses décisions antérieures au sujet des critères permettant de distinguer la présence d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise.